LA COMPAGNIE SUCRIERE SENEGALAISE PEUT-ELLE BENEFICIER D’UNE TELLE PROTECTION ?
Le Sénégal pourrait-il se permettre d’interdire l’importation du sucre pendant cinq ans ?
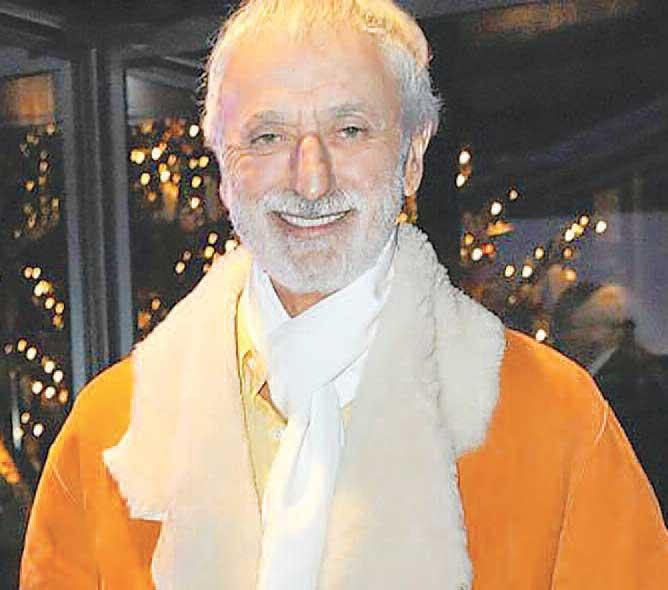
Le Sénégal pourrait-il se permettre d’interdire l’importation du sucre pendant cinq ans ? La question mérite d’être soulevée pour apprécier de la justesse de la mesure décidée par le gouvernement ivoirien le 25 janvier dernier. Le patriotisme économique ivoirien ne cherche qu’à sauver la production locale de sucre malmenée par des importations sauvages venant du Brésil, de Chine ou de Thaïlande. Au niveau de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css), la mesure ivoirienne est bien appréciée. Elle fait sourire, mais à Richard Toll, on indique qu’il n’est pas encore possible d’arriver à un tel schéma même si on souhaite que l’Etat améliore grandement la gestion des importations le 29 janvier dernier, le gouvernement ivoirien décidait en Conseil des ministres d’interdire l’importation de sucre dans le pays pour une durée de cinq ans. la mesure, conséquence directe d’une étude commanditée par le ministère du Commerce et de l’Industrie sur « la rentabilité globale et le niveau de compétitivité des entreprises sucrières ivoiriennes, à partir d’une analyse de la structure des prix et de l’évaluation du coût à l’importation », doit permettre aux deux industriels du pays, Sucaf, filiale de Somdiaa, et Sucrivoire, de Sifca, de mettre à niveau leurs installations sans craindre la concurrence.
Selon Jeune Afrique qui donne l’information, la volonté du gouvernement ivoirien est de protéger temporairement l’industrie sucrière locale pour permettre à cette dernière d’investir et d’améliorer sa compétitivité pour répondre à une demande toujours croissante. l’étude, en montrant la faible compétitivité de l’industrie locale ivoirienne concluait qu’elle est incapable en l’état de rivaliser avec les importations venues du Brésil, de Chine ou de Thaïlande et de satisfaire une demande croissante. la consommation ivoirienne était estimée à 243 000 tonnes en 2018 tandis que la production locale, elle, n’était que de 197 270 tonnes. Par conséquent, elle ne couvrait que 80,96 % des besoins nationaux. Pour accompagner les deux industries de sucre en termes d’investissement, le gouvernement ivoirien envisage de signer des « contrats-plans » avec chacun des sucriers
La compagnie sucrière sénégalaise (CSS) peut-elle bénéficier d’une telle faveur ?
Au niveau de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), des dirigeants interrogés sur la possibilité pour l’etat sénégalais de prendre une mesure d’interdiction similiaire à celle qui va être mise en œuvre en Côte d’Ivoire, répondent qu’il leur serait difficile d’arriver à garantir une totale prise en charge des besoins du marché. malgré des investissements massifs de près de 100 milliards de nos francs, la CSS, qui a pu porter sa production annuelle à 150.000 tonnes, ne parvient pas encore à satisfaire la totalité de la demande estimée à 200.000 tonnes. Ce qui fait que le deuxième employeur du pays après l’état avec environ 7500 travailleurs est obligé de composer avec les importateurs de sucre qui sont titulaires des fameuses déclarations d’importation de produits alimentaires (DIPA). Au niveau de la société de Jean Claude Mimran, on a toujours dénoncé le désordre qui règne au niveau des Dipa données dans des conditions douteuses, électoralistes et non avouées. les importations sauvages rendues possibles par la Dipa font d’autant plus désordre que la CSS a engagé depuis 2015 un plan d’investissement en deux phases de près de 240 milliards de frs pour étendre ses capacités de production à 200.000 tonnes annuelles d’ici 2021 afin pouvoir couvrir les besoins du marché local. la première phase lui a permis d’atteindre près de 150.000 tonnes annuelles.
L’usine compte démarrer rapidement la deuxième phase. D’ici une ou deux années, la CSS pourrait donc être à même de couvrir les besoins domestiques. Ce qui lui permettrait alors de revendiquer la même protection que le gouvernement ivoirien vient d’accorder à son industrie sucrière nationale. Tout cela suppose bien sûr que l’état ait la fermeté de mettre de l’ordre dans les DIPA. Ce qui est une autre paire de manches !











