ET SI NOUS PARLIONS DES FONDS POLITIQUES ?
Que l'on se comprenne bien ! Il ne s'agit pas de questionner les principes de droit ou de finances publiques, voire la tradition ou la jurisprudence, mais bien la sociologie et la morale politiques
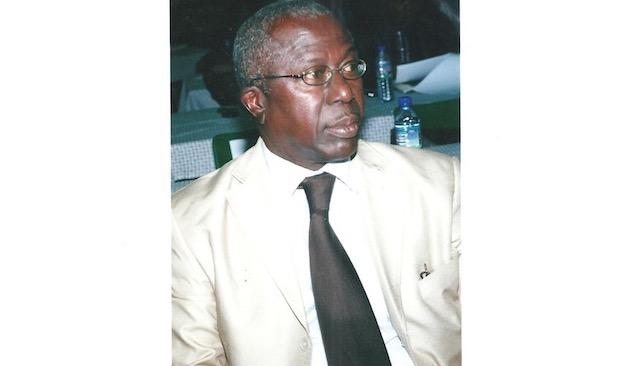
La nébuleuse affaire des 74 milliards du fameux "Protocole de Rebeuss" nous empoisonne l'existence depuis bientôt onze ans. Que ce "Protocole de Rebeuss" ait un lien avec les fonds politiques, les "Chantiers de Thiès", ou encore des fonds versés par une puissance pétrolière arabe, ou que le montant avancé soit différent de la réalité, ne nous intéresse pas outre mesure, pour autant que la justice de notre pays parvienne, un jour, à démêler l'écheveau, à en élucider les tenants et aboutissants et à situer les responsabilités éventuelles, en termes de détournement des deniers publics et/ou d'enrichissement illicite. A condition, bien sûr, que cela ne soit pas une opportunité de plus, pour des règlements de comptes politiciens !…
De notre point de vue, au-delà de l'absence de morale et d'éthique de certains de nos dirigeants, que peut révéler une telle affaire, les questions qu'il convient de se poser aujourd'hui à la lumière de ses différentes péripéties sont celles de savoir s'il est indiqué de maintenir en l'état, au bout de 56 ans d'avancées de notre processus démocratique, la notion et les principes actuels des fonds politiques.
Que l'on se comprenne bien ! Il ne s'agit pas de questionner les principes de droit ou de finances publiques, voire la tradition ou la jurisprudence, mais bien la sociologie et la morale politiques. Il s'agit de s'interroger, d'une part, sur le montant élevé de ces fonds politiques, au regard de la relative modicité de nos ressources budgétaires et, d'autre part, sur la transparence qui devrait prévaloir dans leurs modalités d'attribution et de gestion.
L'on nous dit que les fonds politiques sont des fonds dont la gestion et l'utilisation sont entre les mains du chef de l'État, qu'ils ne sont, ni traçables, ni justifiables et qu'ils servent à financer, ponctuellement, les besoins d'autorités coutumières, de chefs religieux, ainsi que de certaines franges des couches défavorisées de notre société.
S'il est donc vrai que ces fonds n'ont pas pour vocation de constituer un "butin" de guerre du parti au pouvoir, de s'attacher les services d'une clientèle politique, de promouvoir la transhumance d'anciens adversaires politiques, d'entretenir un clan, voire d'amadouer ou de corrompre des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, pourquoi le Président de la République ne pourrait-il pas communiquer sur l'utilisation de ces fonds politiques, dès lors qu'il serait sensé les avoir utilisés à bon escient, à travers des actions de solidarité véritable, au niveau national comme international ? Ne pourrait-on pas s'imaginer que ces fonds puissent comporter différentes rubriques, dont une seule aurait la nature de "fonds secrets" destinés à couvrir des opérations sensibles ou risquées pour la cohésion nationale, ou d'assistance sous régionale, ou encore de "secret-défense" ?
Au demeurant, les initiés et les personnes bien informées savent très bien que le chef de l'État dispose en sus, à travers la rubrique "dépenses communes" du ministère chargé des finances, d'un levier additionnel pour mobiliser des ressources en complément de ces fonds politiques.
Dans les grandes démocraties, où les hommes politiques -à quelques très rares exceptions près- ont une haute idée de leurs missions et de l'exemplarité devant caractériser leurs actions, il est impensable que les fonds politiques puissent être utilisés à d'autres fins que celles auxquelles ils sont destinés. Ne serait-il donc pas temps que nos hommes politiques se préoccupent d'adopter une posture morale basée sur une éthique de responsabilité, qui participe à l'évidence des conditions critiques du devenir de notre pays ? Sommes-nous condamnés à ne jamais disposer de dirigeants au leadership réel, respectant les biens publics et les principes et règles de la droiture ?
En France, l'on ne parle pas de "fonds politiques" mais de "fonds spéciaux", qui sont des crédits consacrés au seul financement d'actions liées à la sécurité extérieure et intérieure de l'État. Ils font néanmoins l'objet d'un contrôle, même si celui-ci est réalisé dans des conditions confidentielles, les missions de renseignement et opérations extérieures concernées ne pouvant être financées sur des crédits budgétaires "classiques" soumis aux règles de transparence.
Certes, au départ, un climat de suspicion les avait entourés, ces fonds spéciaux ayant été parfois détournés pour payer des compléments de salaires à des agents publics ou pour financer illégalement des partis politiques ou des campagnes électorales, mais, depuis une réforme intervenue en 2001, ces fonds sont réservés aux seuls services de sécurité.
Aux États-Unis, il n'y a pas à notre connaissance d'exemple comparable, toutes les dépenses décidées par la Maison-Blanche, fussent-elles destinées à des opérations "sensibles" ou "spéciales", doivent recevoir l'aval préalable, selon le cas, soit du Congrès, soit du Conseil National de Sécurité et, dès lors, le problème du contrôle a posteriori de l'utilisation des ressources en question ne se pose pas.
L'opportunité d'une réforme de la pratique et de la gestion des fonds politiques au Sénégal s'adresse donc, non pas aux seuls juristes et financiers, mais au législateur, entendez les citoyens dans leur totalité, à travers la représentation nationale. Elle doit être une préoccupation de la classe politique dans son ensemble, comme élément essentiel de la moralisation de la vie politique. Certes, de par la nature de ces fonds, la question de la reddition des comptes ne peut être ici que morale, les juridictions ne pouvant connaître de leur gestion.
Elle devrait cependant pouvoir être du ressort d'une haute instance morale, telle que la "Haute autorité de régulation de la démocratie" proposée par la CNRI, ou une "Commission de vérification des fonds politiques", à l'image de la Commission française de vérification des fonds spéciaux - ou encore une entité s'en rapprochant - et, au besoin, être sanctionnée par une réprobation, un désaveu pouvant remettre en cause une éventuelle réélection, à l'instar des maires dont les fautes de gestion, dûment constatées et publiées, n'en font pas pour autant des justiciables de la Cour de discipline budgétaire, du fait du risque encouru d'une sanction populaire lors de consultations ultérieures.
En acceptant, en bon républicain, de soumettre sa gestion de nos deniers publics à l'examen d'une telle entité indépendante, l'actuel Président de la République ne peut qu'en sortir grandi et voir sa légitimité renforcée. C'est pourquoi, à défaut d'une inscription de cette question des fonds politiques à l'agenda du dialogue national en cours, notamment au niveau de la commission s'occupant des affaires politiques et électorales, il nous semble particulièrement opportun d'engager, avec l'ensemble des forces vives de la Nation, un large et véritable débat national sur la question.
Comme l'ont déjà dit certains compatriotes, dont notre camarade Mody Niang dans un article paru dans la presse en janvier 2015 : "Nous devrions en repenser l'esprit et la philosophie, et discuter sérieusement de leurs montants comme de la manière dont ils sont gérés".
Mohamed Sall Sao
Expert international en gouvernance administrative et politique
Membre fondateur de la Plateforme "Avenir, Senegaal bi ñu bëgg"











