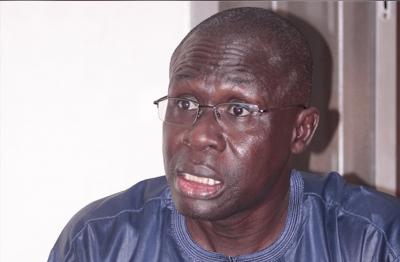ET SI ON REVENAIT AUX FONDAMENTAUX DE LA CULTURE ?

Il y a quelques semaines, en réunion avec les ambassadeurs et consuls de notre pays à l’étranger, le président de la République les avait incités à pratiquer désormais de la diplomatie économique, en lieu et place ou en sus de la diplomatie classique. Une chose est sûre en tout cas, il n’a pas eu un mot pour la diplomatie culturelle, celle-là qui a pourtant tant fait rayonner l’image de notre pays à l’étranger. Sûr que le poète-président Léopold Sédar Senghor, premier Président du Sénégal indépendant, pour qui la culture est à la base de tout développement économique, n’aurait pas agi de la même manière que lui.
En effet, il a su mener une véritable diplomatie culturelle durant tout le temps qu’il a été au pouvoir avant qu’elle ne soit jetée aux orties à son départ volontaire du pouvoir en décembre 1980 suivie de l’arrivée aux affaires de son ancien Premier ministre Abdou Diouf. Celui-ci, prisonnier des politiques d’ajustement structurel à son accession au pouvoir, avait décidé sous la contrainte des institutions de Bretton Woods de couper les vivres à la Culture. En même temps, sur le plan de la communication, ses zélateurs s’étaient lancés dans une grande entreprise de « désenghorisation » consistant à faire oublier son illustre prédécesseur.
Conséquence de ces politiques, les artistes s’étaient retrouvés orphelins de Senghor. Cependant, bien des années plus tard, Abdou Diouf avait semblé revenir à de meilleurs sentiments avec le lancement d’initiatives phares dans le domaine culturel comme la Biennale des Arts et Lettres devenue celle des Arts tout court en plus d’offrir aux artistes un village pour exercer leur art. Et c’est à juste titre qu’il avait reconnu son erreur lors de l’ouverture de la première biennale consacrée aux Lettres. En effet, s’adressant à son prédécesseur, Senghor, Abdou Diouf avouait : « Monsieur le Président, l’histoire vous a donné raison. L’heure des peuples a sonné et c’est bien l’heure de la culture et de la liberté ».
Toutefois, malgré quelques efforts, et en dépit de la Biennale de l’Art Africain, la culture n’a jamais été considérée par nos hommes politiques comme un enjeu économique. Ces derniers ont en effet toujours misé beaucoup plus sur le folklore que sur la vraie culture susceptible de devenir une industrie, véritable poumon du développement économique. C’est ce que résume l’ancien ministre de la Culture Makhaly Gassama dans son tout dernier ouvrage intitulé « Politique et poétique au sud du Sahara ». Pour cet éminent critique littéraire, « même le développement culturel commence à nous échapper ».
En effet, à en croire l’ancien ministre de la Culture sous Abdou Diouf, « les véritables ministères de la Culture en pays francophones, ce sont les centres culturels français ». Son constat est qu’eux seuls font ce que les ministères de la Culture auraient dû faire de mieux dans nos pays. C'est-à-dire « les échanges culturels, les déplacements de nos artistes, de nos écrivains de pays en pays (qui) relèvent désormais de leur volonté. ». Bien sûr, tout cela a aussi son effet contreproductif en ce sens que nos créateurs se livrent mains et pieds liés à l’Occident. Une des conséquences de cet état de fait est ce que l’on appelle la colonisation culturelle, marchant selon les désidératas de l’autre. Et aucune discipline artistique n’échappe à ces colons culturels occidentaux. Les écrivains sont choisis selon leur propre grille de lecture tout comme les productions de nos cinéastes, lesquels sont financés selon leur bonne humeur.
« On devine les effets secondaires que cette assistance doit produire sur leur comportement et sur leurs créations », écrit sans aspérité l’exégète de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma. Et de s’interroger : « Que sont devenus les nombreux échanges culturels entre nos pays et entre les différentes régions du même pays ? Que sont devenues nos infrastructures culturelles, comme les Tapisseries de Thiès, au Sénégal, dont les œuvres décorent les palais les plus prestigieux dans le monde ? Qu’est devenue la diplomatie culturelle du Sénégal à travers des conférences et des expositions d’œuvres de nos grands artistes en Afrique et dans le reste du monde ? Un immense capital détruit ! Ce sont bien ces activités qui ont forgé, ciselé l’image du Sénégal à travers le monde, une image dont la qualité exceptionnelle jure avec son poids économique ».
Une vérité cruelle mais une vérité quand même qui montre encore une fois, malgré tous les programmes développés ces vingt dernières années, combien est grand notre retard culturel. En fait, ce sont toutes ces interrogations de l’ancien ministre qui sembleraient manquer à la culture sénégalaise pour son véritable développement. Il serait donc intéressant de revenir à ces fondamentaux qui avaient placé la culture de notre pays au centre du monde jusqu’à faire du Sénégal la locomotive de la culture du continent. Il est toujours permis de rêver !