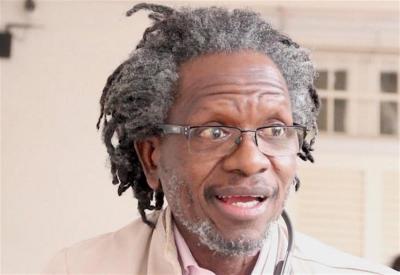LA MÉNOPAUSE, UNE ÉTAPE REDOUTÉE PAR BEAUCOUP DE FEMMES
VIE DE COUPLE

La ménopause est définie comme la cessation permanente des menstruations, résultant de l’achèvement de la fonction ovarienne (Oms). À sa survenue, la femme perd totalement la possibilité de procréer. Généralement associée à de complexes changements où s’entremêlent facteurs biologiques (physiologiques) et environnementaux (sociaux et culturels), la ménopause constitue dès lors une phase sensible de la vie de la femme, tant sur le plan physiologique que psychique voire même dans certains cas sociaux.
Le champ des études sur la ménopause est très vaste et couvre divers domaines de recherche, allant de la démographie à la médecine, en passant par l’anthropologie. Les conséquences de la ménopause sont également nombreuses et étroitement liées à la santé de la femme.
« L’âge de la survenue de la ménopause est très variable aussi bien chez les individus de la même population, que chez des populations différentes. À travers le monde, cet âge est situé dans l’intervalle de 43 à 50 ans (Oms 1996). D’autres donnent à l’intervalle de l’âge normal de la ménopause encore plus large, s’étalant de 42 à 55 ans », note Marème Ndiaye, sage-femme.
Les symptômes de la ménopause se manifestent par une combinaison de changements physiques. La vulnérabilité physique et psychologique de la ménopause découlant d’influences culturelles et des perceptions individuelles est d'une manière générale associée à une véritable crise existentielle, et à une remise en question importante des valeurs de la femme et de son rôle qui est limité à la procréation dans de nombreuses sociétés.
« Les symptômes les plus déclarés par les femmes sont en premier lieu d’ordre physique : fatigue, problèmes d’articulation. En deuxième lieu, ils sont d’ordre émotionnel : un désir sexuel qui tend à se diminuer. Il semble que cette situation soit partagée par la plupart des populations. Le fardeau familial subi par la femme, associé à la perte d’une vie reproductive intense, peuvent être des éléments explicatifs de ce résultat qui débouche sur un stress apparent », mentionne Marème Ndiaye, sage-femme.
La crise identitaire de la ménopause est aussi fortement liée à la réalité inéluctable du vieillissement. La plupart des femmes n'abordent pas ce sujet, trop menaçant à leurs yeux.
Elles l'expriment pourtant souvent avec intensité à travers d'autres plaintes.
L'arrêt de la fécondité
L'arrêt de la fécondité est perçu avec équivoque. Même si le discours mis en avant est celui du soulagement ou de l'indifférence, un regret peut apparaître, surtout lorsque la perte de la fécondité est liée à une perte de statut social.
A cet égard, certaines femmes interrogées se déclarent indifférentes à cette conséquence de la ménopause et y voient même parfois une libération, avec la fin du risque d'être enceinte.
Par contre, d’autres regrettent de ne plus avoir aucun espoir de grossesse. En revanche, elles expriment une forte désolation vis-à-vis de l'arrêt de la fécondité, avec à la fois du regret pour certaines et un sentiment de libération pour d’autres.
Pour certaines femmes, la perte de la fécondité est vécue comme une perte importante et douloureuse alors même que le désir d'enfanter existe encore. Elles se sentent comme amputées, dévalorisées par rapport à celles qui peuvent encore accoucher.
Ndèye Fatou Guèye, 52 ans, 9 enfants, a été très déprimée par la ménopause. Elle s’est sentie inutile à l’arrêt des règles. « Je ne me plains guère, au contraire, je me réjouis d’avoir pu mettre 9 enfants au monde. Plusieurs femmes n’ont pas eu cette chance.
Toutefois, mon inquiétude se situe ailleurs. Avec ma prise d’âge, et la survenue de la ménopause, je crains que mon mari trouve un alibi en béton pour aller chercher une deuxième épouse. D’autant que nous sommes pratiquement de la même génération et lui peut encore, en tant que homme, avoir des enfants », tranche Ndèye Fatou, apparemment la peur au ventre.
Pour d’autres, l'arrêt de la fécondité est décrit comme une perte, mais relativement peu importante. C'est souvent les femmes qui ont eu les enfants qu'elles désiraient qui digèrent mieux la ménopause comme un phénomène naturel. Anthia se dit indifférente à son nouveau statut de ménopausée.
Elle est « aujourd’hui plus que jamais déterminée à prendre soin de son mari et afin à s’épanouir dans son foyer ». Quand on évoque le risque de voir son conjoint chercher une épouse plus jeune, elle est persuadée que cela ne saurait se produire. « Même si je ne pouvais pas avoir des enfants, mon mari et moi aurions adoptés. Il m’aime d’un amour naturel et désintéressé et ma nouvelle condition de ménopausée n’y changera rien », tranche-t-elle sans équivoque.
En effet, dans certaines situations, le statut définit la place de la femme dans la société africaine ainsi que les rôles sociaux qu'elle remplit. Certaines femmes interrogées pensent que « les gens les considèrent en général comme une femme sans changement particulier » avec l’atteinte de la ménopause.
Dans ces cas, la femme ménopausée est en effet regardée comme une femme « dans sa maturité ». Une minorité de femmes seulement perçoit une perte du statut dans ces cas spécifiques : « Les gens considèrent une femme ménopausée comme une vieille dame ou comme une grand-mère », note Anthia.
La ménopause est un évènement naturel de la vie, mais qui est entouré de multiples mystères et spéculations, oscillant entre gain et perte, contraintes et libertés.
Certaines femmes admettent que la ménopause s'accompagne d'un changement de statut social, mais s'efforcent de lui donner une valeur positive ou d'en diminuer la portée : « Je vois cela comme un cap, le tout c'est d'être bien dans sa peau », confie cette fonctionnaire âgée de 47 ans. Une forte partie d’entre elles envisage même la possibilité d'un gain de nouveau statut.
Elles adhèrent à l'opinion : « La ménopause est une période d'épanouissement ». Dans le même registre, d’autres femmes estiment que « la ménopause est une période où l'on peut enfin s'occuper de soi », que « la ménopause est une étape où elles deviennent sereines ».
Influence de la représentation culturelle
Une femme est dépendante de son destin physiologique, heurté et rythmé par les grandes étapes biologiques : puberté, fécondité et ménopause.
« La femme vieillissante est à l’âge dangereux, où la réalisation de son inutilité sociale par la perte de la fécondité l’amène immanquablement dans la tourmente », disait Simone de Beauvoir, dans son œuvre intitulée «Le deuxième sexe ».
Même si elles l’admettent difficilement, les femmes sont, au fond, nombreuses à être d’accord que la ménopause est le début de la vieillesse, résultant d’une symbolique forte.
Chez les femmes qui perdent leur identité sociale en même temps que leurs règles, la ménopause engendrerait un cortège de troubles pénibles voire invalidants.
En plus de ce changement de statut social, l’existence de croyances positives ou négatives liées à la ménopause font parfois apparaître de nouveaux symptômes.
Ainsi, l’image de la femme caractéristique aux multiples troubles psychologiques résulterait plus d’un stéréotype culturel que de facteurs biologiques.
Volonté de séduire
« La plupart des femmes manifestent la volonté de vivre la ménopause de manière naturelle. Elles revendiquent un statut de femme mûre que la sexualité ou la séduction n’intéressent plus et qui préfèrent le rôle de grand-mère derrière ses fourneaux », souligne Marème Ndiaye.
Quant à la séduction, les hommes catalogueraient les femmes en deux groupes, celles qui démissionnent, abandonnant tout effort d’entretien et adoptant un profil de « grand-mère » et celles vivant bien leur ménopause, gardant la volonté de séduire et restant actives dans leur vie sociale.
Cette situation expliquerait le fait que cette échéance est redoutée par certaines femmes. « Lorsque la ménopause est survenue, mon mari, en entente avec sa famille, est parti chercher une autre jeune épouse.
Il disait pouvoir et vouloir encore enfanter, ce qui n’était pas mon cas, raison pour laquelle il est parti convoler en secondes noces », affirme cette dame âgée de 50 ans que nous appellerons Oumou.
Toutefois, certains époux se défendent et nient sombrer dans le désir de chercher ailleurs une fois que leur partenaire a atteint le cap de la ménopause.
Dame Dieng, un vieux âgé de 66 ans, narre son histoire : « Je capitalise 36 ans de vie de foyer. Je ne connais que ma femme et elle me suffit largement. Ce n’est pas à mon âge que je vais voir ailleurs », laisse-t-il entendre.
Le sieur se refuse toutefois de condamner ceux qui cherchent une deuxième femme dans cette période fatidique de ménopausée. « C’est leur choix que je respecte d’ailleurs », tout en précisant qu’il ne le fera jamais.
Dame ne voit dans le choix des autres aucun signe de trahison ou d’infidélité, mais le dépeint comme une posture découlant d’un choix pleinement assumé.
D’autres, même s’ils refusent de l’admettre, ont carrément abandonné leur épouse, après que celle-ci n’est plus en mesure de mettre des enfants au monde.
Ils refusent obstinément d’accepter la réalité dans sa triste laideur et vont sans état d’âme mettre « au frigo » leur conjointe pour aller à la recherche de nouvelles conquêtes.
Des histoires similaires à cette situation font légion, mais peu sont enclins à revenir dessus. Ces femmes sont souvent victimes innocentes d’une injustice de leur mari à la recherche de nouvelles « prairies plus vertes ».
La vue des règles est source d’angoisse chez certaines femmes. Un grand nombre d’entre elles dit garder le souvenir d’un vécu négatif de leurs menstruations, source de gêne ou de douleurs.
Une fois débarrassées de ce qu’elles appellent la servitude menstruelle, elles sont peu enclines à accepter la réapparition de saignements.
Ce qui de façon globale dénote que les femmes acceptent leur statut de ménopause.
Leur inquiétude, pour celles qui en manifestent, se situe plutôt sur le regard de la société.