LE SYSTÈME BRETTON WOODS À L'ÉPREUVE DE TRUMP
Après avoir claqué la porte de plusieurs organisations internationales, le président américain fait retenir son souffle au FMI et à la Banque mondiale. Premier contributeur, Washington pourrait bouleverser ces piliers de la stabilité financière mondiale
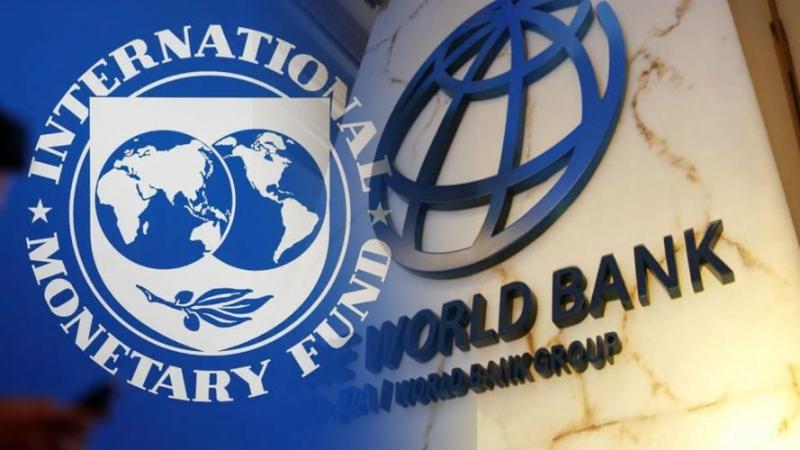
(SenePlus) - Dans un contexte économique mondial tendu, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale tiennent cette semaine à Washington leurs premières réunions depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Ces deux piliers du système économique international, nés des accords de Bretton Woods en 1944, font face à des remises en question sans précédent de la part de l'administration Trump, comme le rapporte Le Monde.
"Nous vivons dans un monde de revirements soudains et radicaux", a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, le 17 avril dernier, précisant que cette situation "nous impose de réagir avec sagesse". Une déclaration qui intervient alors que Donald Trump a demandé une revue complète, d'ici le mois d'août, de toutes les participations américaines dans les organisations internationales.
Cette remise en question intervient dans un contexte où le FMI vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025, à 2,8%, soit une réduction de 0,5 point de pourcentage par rapport à janvier. Cette révision est directement liée à l'offensive protectionniste de l'administration Trump.
Le FMI, qui a traditionnellement évité d'aborder frontalement la question des déséquilibres commerciaux, semble désormais prendre en compte les préoccupations de Donald Trump. L'institution pointe du doigt "une consommation trop faible en Chine, qui pousse cette dernière à écouler sa production vers le reste du monde et, a contrario, d'une demande américaine si élevée qu'elle creuse son déficit commercial et augmente sa dette", comme le souligne Le Monde.
Cette nouvelle approche paraît être une réponse au "principal grief de Donald Trump, à savoir que les Etats-Unis financent les excédents commerciaux du reste du monde en creusant leurs propres déficits."
Premier contributeur du FMI avec 16,1% des droits de vote (contre 6,1% pour la Chine), les États-Unis disposent d'un droit de veto sur les décisions importantes de l'institution. Si un retrait complet des États-Unis semble peu probable, certains analystes envisagent des scénarios où "les États-Unis pourraient contraindre le FMI à restreindre ses prêts en direction de certains pays rivaux ou alignés sur la Chine", selon William Jackson, économiste chez Capital Economics, cité par le quotidien français.
Elizabeth Shortino, ancienne directrice exécutive du FMI, souligne dans une note publiée mi-avril par l'Atlantic Council que "le coût de sa participation est faible alors que son rôle dans la lutte contre les crises financières est inestimable pour l'économie américaine". Elle ajoute qu'un retrait américain permettrait à la Chine, qui "se pose en nouvelle gardienne d'un ordre économique mondial fondé sur des règles, de jouer un rôle de premier plan dans l'institution."
Le FMI, dont la mission principale est d'assurer la stabilité du système financier international, dispose de réserves s'élevant à 1 000 milliards de dollars (environ 872 milliards d'euros) pour venir en aide aux pays en difficulté comme l'Égypte, le Pakistan ou l'Argentine. L'institution joue également un rôle central dans la restructuration de la dette des pays pauvres.
Dans ce contexte de tensions géopolitiques accrues et de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les discussions qui se tiennent cette semaine à Washington revêtent une importance particulière pour l'avenir du système économique mondial tel que nous le connaissons depuis près de 80 ans.













