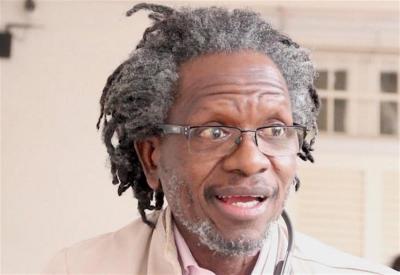Crise du débat politique et de la démocratie au Sénégal : au-delà de la presse et de la politique

Voilà quatorze mois que le nouveau pouvoir au Sénégal dirigé par le Président Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yaakar (l’Unité pour l’Espoir) se débat entre une mise à l’épreuve difficile et des promesses perçues comme un horizon lointain par une bonne partie de l’opinion publique. Au sein de la classe politique en général, et de la coalition au pouvoir en particulier, les tentatives d’explication sont aussi dispersées qu’elles ne semblent converger vers une seule cible, en l’occurrence le Président de la République Macky Sall.
D’aucuns voient dans cette purge qui ne dit pas son nom un prélude à la dislocation de ladite coalition qui pourrait se justifier par l’imminence des élections locales de 2014 qui constituent le premier test politique du nouveau régime. Pour d’autres, y compris certains parmi les observateurs les plus avertis, cette guéguerre au sein de la classe politique est en partie liée à la résistance du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et de ses alliés restés fidèles après la défaite sans surprise du 25 mars 2012.
Cette rébellion serait dirigée contre les politiques d’assainissement de la gouvernance publique du régime actuel dans la mesure où elles impliquent un audit et des sanctions formelles de leur gestion. Tandis que l’opinion se cristallise de plus en plus contre la classe politique dans son ensemble, notamment au sein de l’intelligentsia et du secteur privé, cette chienlit politico-médiatique s’exerce par une violence particulièrement insidieuse. De quoi nous amener à repousser les limites de la réflexion.
En effet, plus qu’une niaiserie politique intra et inter-partisane grandeur nature, cette opinion semble mettre en cause une crise du débat politique dont les politiciens serait les coupables. Contre et au-delà de cet argument, le journaliste Pape Sadio Thiam1, n’a pas tort de fournir une analyse qui élargit l’accusation à son corps de métier, à savoir la presse en général, et les journalistes en particulier. Selon lui, le refus du dialogue en relation fonctionnelle et ou hypothétique avec la corruption et l’indigence professionnelle des journalistes serait à l’origine de cet appauvrissement du débat politique et partant de la régression de la démocratie au Sénégal.
Sans différer fondamentalement avec lui sur la réalité et les conséquences de cette crise, nous nous permettons d’introduire ici des questionnements et des contre-arguments à cette analyse. Nous estimons que si l’accusation contre les journalistes est fondée, son caractère quelque peu épidermique ne permet de révéler les implications profondes de cette crise du débat politique. En sus de cette principale remarque, nous invitons à imaginer les ressorts de cette crise et ses implications au-delà d’une conception communicationnelle de la politique, elle-même liée à une vision technicienne de la communication et de l’interaction politiques.
Si le débat est en crise, cette dépréciation intervient moins au niveau de sa valeur fonctionnelle ou opérante par rapport au modèle, aux velléités populaires et aux trajectoires de la démocratie au Sénégal qu’à celui de sa valeur marchande. La crise du débat est réelle mais celui-ci reste un business qui marche pour ses principaux animateurs, à savoir une bonne partie de la presse et de la classe politique.
Nous faisons reposer notre perspective sur trois éléments : d’abord, sur le fait que l’analyse de Pape Sadio Thiam semble s’appuyer en filigrane sur une mythologie propre à la démocratisation au Sénégal. Ensuite, sur un étayage des relations entre presse et classe politique d’une part, entre les deux et les autres acteurs de la vie politique sénégalaise d’autre part. Enfin, sur la condition même de la presse et de la classe politique qui découle de ces relations.
Le prisme de la mythologie : la presse, la démocratisation et la démocratie
Il y a deux mythes dans lesquels on a souvent enfermé le modèle politique sénégalais. On peut se garder momentanément d’ailleurs de parler de modèle démocratique sénégalais dès lors que l’on admet l’existence d’une crise de la démocratie ; un modèle étant en politique une matrice de référence en comparaison à des situations perçues comme étant de moindre sophistication sociopolitique. L’idée d’une mythologie n’enlève en rien le fait largement établi que le processus de démocratisation doit beaucoup à l’émergence de la presse. Parce qu’il est en lui-même une forme d’explication du réel, le mythe n’est ni une négation ni un contraire du réel. C’est son potentiel d’affabulation et donc de détournement du réel qui est suspecté ici.
Le premier mythe est relatif à l’idée que la presse est gardienne de la démocratie dont elle aurait été à l’origine. Dans la logique du second, il consiste en la conviction que le Sénégal est une démocratie avancée, pour ne pas dire la plus parfaite, parmi les plus connues. Il faut rappeler que la mesure de la démocratie, par suite de vagues de transitions institutionnelles, relève davantage de la normativité internationale dont on sait à quel point elle peut être inéluctable. Il s’y ajoute que le premier mythe laisse penser que les autres acteurs, y compris la classe politique et la société civile, ne sont souvent que des héritiers peu méritoires de la presse.
Cette dernière, à l’image de la caste dirigeante militaro-tribale en Algérie et en Mauritanie, se pense et s’impose à la société politique comme l’accoucheur et le bénéficiaire historique de l’ordre politique. Cette vision à n’en pas douter érige la presse en seigneur dudit ordre. De quoi amener cette dernière à croire devoir en assurer la permanence, y compris contre tous ; ce qui pourrait conduire à une situation où la presse se verrait en droit de favoriser ou d’entraver des changements, selon ses vérités et les conjonctures qui les remettraient en cause.
En démocratie le statut de la presse est octroyé par le projet démocratique qui vise en amont à empêcher que le contrôle politique ne soit déséquilibré au profit d’une partie, fut-elle minoritaire ou majoritaire, et en aval à garantir l’existence et l’exercice des droits et des libertés de manière non exclusive. Or, au Sénégal ni l’un ni l’autre de ces deux fondamentaux n’étaient réunis au moment des premières velléités de démocratisation à la fin des années 80. Pas plus qu’il n’existait de presse libre, encore moins de presse privée.
Ce n’est pas de la vaine histoire que de rappeler cela, en ce sens qu’il s’agit ici de prévenir contre les mythes. La presse en général et la presse privée en particulier prétendent souvent avoir joué et continuer de jouer un rôle de sentinelle de la démocratie. Le fait est qu’elle n’a été qu’un acteur parmi d’autres de ce long processus de démocratisation qui a été d’abord conduit par les syndicats, les mouvements étudiants, les corporations et les populations de manière générale, cela depuis les années 70 et 80. Ce n’est qu’en 1994 qu’une véritable presse privée a commencé à éclore au Sénégal.
Fort de cela, nous estimons que c’est aux populations de se prévaloir, de préserver et de défendre les acquis démocratiques. D’un point de vue fonctionnel, il n’est pas fondamentalement du ressort de la presse de « défendre » une démocratie quelconque dès lors que ce n’est pas à elle que revient la prérogative d’octroyer des libertés telles que la liberté d’expression et d’opinion.
Le second mythe est en amont que le modèle sénégalais est déjà parfait, tout simplement parce qu’un acteur historique – la presse – existe pour en avoir déterminé la genèse et en garantie le maintien. Or, le problème qui se pose c’est en l’occurrence une dégénérescence de la politique (au sens de processus compétitif de distribution du pouvoir) doublée d’une crise d’intelligibilité du débat politique. Il s’agit en effet d’une régression démocratique, ainsi que l’a si bien souligné Pape Sadio Thiam. L’espace public sénégalais est en continuelle fragmentation. Le champ politique est de plus en plus émietté par une kyrielle de partis politiques en manque de production idéologique et de démocratie interne.
La société civile est écartelée entre des mouvements populaires dépourvus de spontanéité politique d’une part, et un leadership dont le formalisme pseudo-légaliste et l’internationalisme idéologique d’autre part, cachent mal la promotion d’agenda aussi extravertis que leur survie interne impose des acrobaties équilibristes aux confins des partis politiques et des foules déchainées. Pour leur part, les syndicats ont souvent donné l’impression de vouloir garder des privilèges accumulés au travers d’une logique ambivalente de soutien-chantage à la classe politique.
Ce faisant, ils sont demeurés incapables d’introduire et de maintenir de façon durable la question sociale dans un débat politique « indigénisé » en permanence par une classe politique ainsi confortée dans son immobilisme débonnaire et son amnésie volontaire. Ce n’est pas rien signifier si la violence du langage et de la tactique ainsi que la veulerie militante sont restées les stratagèmes par excellence de notre classe politique pendant des décennies. Pourtant, on ne peut pas nier le fait que la pauvreté galopante et la hausse vertigineuse du coût de la vie, parallèlement à une crise continuelle de l’emploi et des services sociaux, ont alimenté les fronts du refus qui ont généré les deux alternances de ces douze dernières années.
Sans vouloir paraitre caricatural, on peut dépeindre la presse dans cette atmosphère anomique comme deux osselets qui s’articulent parfaitement dans une interdépendance fonctionnelle, laquelle est tout aussi révélatrice de la crise sociopolitique ambiante. D’un côté, nous avons une classe d’affairistes prête à reconvertir « griots » et mannequins en dresseurs des masses et en charmeurs de la bourgeoisie urbaine et de la noblesse rurale.
Cette classe se charge ainsi de créer des emplois précaires et de distraire la plèbe à coups de plagiats et de pacotilles reluisantes. Souvent, on n’est pas loin de nous présenter cette alchimie expéditive comme une ingéniosité qui serait une parfaite mise à profit du pluralisme et de la libéralisation économique dont notre classe politique et notre peuple auraient été de vaillants bâtisseurs à côté du reste de l’Afrique. De l’autre, et au grand bonheur d’une classe politique impuissante et désintéressée par ses échecs séculaires, ces emplois précarisant sont pris d’assaut par une classe de jeunes et de jeunes-adultes souvent diplômés au rabais : filles et garçons, hommes et femmes, déflatés des universités, de l’industrie du loisir, de la décadence du folklore traditionnel ; rejetons immatures ou prématurés des écoles spécialisées du journalisme, de la communication et des industries culturelles.
De la même manière, les cadres de la consommation de prestige et de la nostalgie des royautés d’antan que constituent les productions médiatiques sont indistinctement disputés par les aristocraties tantôt nommées. Que peut t-il bien se passer d’intelligible, de transformateur, de révolutionnaire, de stimulant pour les volontés et pour les rêves largement extériorisés de progrès social et économique si l’espace public est devenu une cour d’orgies et de cohue infestée d’aristocrates, de courtisans et de troubadours ?
Esprit de corps, esprit de cour et complexe d’infériorité chez les professionnels de la presse
« Les journalistes sont souvent enclins à stigmatiser la crise de la pensée au sein de l’élite intellectuelle comme s’ils s’excluaient d’office du cercle des intellectuels et du commerce des idées ou comme s’ils n’étaient pas en partie coresponsables de cette décadence de la pensée dans la société ! ». Pape Sadio Thiam ne pense pas si bien dire en décrivant ainsi ce qui est souvent improprement qualifié d’« esprit de corps » ou de « solidarité de corporation ». L’esprit de corps est bien plus une culture professionnelle – ainsi qu’elle est parfois implicitement encouragée par les lois et règlements – qu’un « esprit de clocher », ou bien ce à quoi nous sommes tentés de l’identifier : un « esprit de cour », pour emprunter un terme du philosophe camerounais Jean-Godefroy Bidima.
Même si on peut différer à propos du fait que la presse s’auto-exclurait de l’intelligentsia nationale ; de la même manière que l’on doutera, quand bien même en partie, du fait qu’elle « stigmatiserait » l’élite intellectuelle. En réalité, l’impression qui semble se dégager des nombreuses émissions radiotélévisées que Pape Sadio Thiam a citées en exemple, les plus parfaites chez nous selon lui, c’est que la presse ne s’exclut pas plus qu’elle n’ostraciserait les « intellectuels » ( au sens des lettrés ou des « évolués »).
Conformément au mythe de son rôle d’avant-gardiste expliqué plus haut, la presse se présente comme la partie de l’élite intellectuelle qui est la plus à même, ou la seule depuis un certain temps – celui de l’alternance de 2000 – de rendre intelligible la quotidienneté et la continuité politiques au Sénégal. Puisqu’elle est la « sentinelle » de cette démocratie conquise par son éclairage et sa volonté, elle s’autorise la censure et la chasse à l’homme contre les dissidents intellectuels et les innovateurs politiques.
Que doit-on comprendre d’autre du fait qu’un groupe quasiment inchangé d’intellectuels (sociologues, politologues, politiciens, chefs religieux, chroniqueurs) est en starring devant le seul et même public d’une chaine de télévision ou de radio à l’autre, d’un quotidien à l’autre ? Que dire d’autre de la tendance des journalistes à se réclamer des mêmes domaines expertises que ces intellectuels ou à s’y reconvertir sans se prémunir des pré-requis matériels et formels établis à cet effet ?
Et parce qu’elle se pose en leadership de l’intelligentsia et, par suite, en détenteur légitime et unique de la vérité ou de la vraisemblance politiques, la presse établit un monopole sur le débat, non pas tant pour et par elle seule, mais avec le concours d’un establishment d’intellectuels, de politiciens et d’entrepreneurs du prestige et de la fortune. Par ce mélange des « miliciens » de la parole publique avec des intellectuels qui « troquent leur carrure intellectuelle » contre une « fourrure politique », dirais-je, le débat est subtilisé et soustrait de l’espace public pour être reclus dans une cour (à la fois au sens de « tribunal » contre les dissidents et au sens de « couloirs » où se font courtiser politiciens, stars et entrepreneurs, et se font louer nobles et bourgeois, plus particulièrement les « néo-parvenus »).
Devant le silence des intellectuels « dégagés » et des analystes « désabusés », qui peut susciter et maintenir un niveau de rationalisation désintéressé et soutenu ? Comment cela pourrait-il facilement arriver si le contexte est celui où la foule résignée à subir s’affaire à amortir sur son échine éreintée les hausses inaltérables et démultipliées du coût de la vie ?
Cela nous pousse à penser qu’en lieu et place d’une « démission tacite des journalistes et des politiciens face à la médiocrité qui gangrène la société politique », on a affaire à une usurpation des velléités de révolution, à une distraction organisée et systématique des déterminations conjoncturelles du peuple, au mépris des projections et des subjectivations historiques qui en sont les soubassements. Et cela passe forcément par une décapitation de la tête pensante du peuple à travers le lynchage en règle des intellectuels engagés, à qui on en veut souvent à cause de leur érudition et leur probité inaltérable.
A chacun de leurs accès de colère pour réclamer du sang neuf et du concret, les masses sénégalaises ont toujours veillé à recycler des figures et des symboles de leur passé jadis glorieux : des mouvements hip-hop et Set-Setal des années 90 jusqu’au mouvement « Y en a marre » et les réseaux sociaux d’aujourd’hui, les figures de la décolonisation panafricaine ont été invoquées à côté des idéaux de la démocratie, de la justice sociale, du progrès. Allant jusqu’à accuser la classe politique et ses alliés historiques de manquer de patriotisme et de compassion, Wade par exemple a été comparé à des figures comme Lumumba et Mandela, ses œuvres contrastées avec celles de ces icones d’une mémoire de dignité recouvrée et d’une gouvernance exemplaire.
Esprit de cour et « clochardisation »de l’establishment partisan et journalistique
Une bonne partie de la presse s’est vue indifféremment dotée d’une puissance subite par un pouvoir wadiste soucieux de faire ses « nouveaux riches » pour mieux faire son appareillage de propagande et de désinformation au sein du peuple. En habile manipulateur, cette presse a su affectionner le « prétexte de la proximité du peuple », non pas pour « justifier [un quelconque] refus systématique de repêcher le débat des profondeurs de la médiocrité », mais pour cacher son incapacité à sacrifier son option pour la « logique de cour » à la demande révolutionnaire du peuple qui n’a jamais cessé d’être affirmée depuis plus d’une décennie.
Tel est selon nous ce que dissimule « le journalistiquement correct » dont parle Pape Sadio Thiam. Et pour ne pas faire accuser notre démonstration de légèreté opportuniste, nous convenons à un autre exercice périlleux, celui qui consiste en particulier à expliquer l’idée d’une usurpation « mafio-capitaliste » du tao politique sénégalais.
La clochardisation des métiers du débat et de la communication politiques
« La corruption a tellement gangrené cette corporation [journalistique] que n’importe quel quidam peut passer dans n’importe quelle émission ». En effet, on se donnerait un mal inutile, et aussi ridicule que l’intention qui le justifierait, à réfuter cette remarque si juste. Et c’est ce qui sera démontré dans les lignes qui suivent. En revanche, ce ne sera pas pour dédouaner les journalistes et leurs patrons-employeurs, y compris les politiciens et les consommateurs de prestige, en les faisant passer pour des victimes innocentes de la « tyrannie du marché » dont parle Pape Samba Thiam.
C’est en effet surprenant d’être victime d’un « marché » dont on a taillé soi-même les frontières pour ses propres coutures. Pour preuve, les radios et les télévisions, les portails en ligne et les journaux écrits n’ont cessé de pulluler dans le paysage médiatique au Sénégal. Mieux, ce marché est tellement juteux et compétitif à souhait que la bataille est souvent ardue, presque sauvage, pour se voler entre « boîtes de presse » les meilleurs accrocheurs de foules et les plus « reseautés » au sein des politiques, universitaires et hommes d’affaires.
Au lieu d’une victimisation qui se prêterait davantage à un angélisme ou une euphémisation suspects, je verrais dans la corruption du journalisme – en liaison avec la corruption du personnel politique – une conséquence de la clochardisation des métiers du débat politique et de la communication. Laquelle précarisation est inséparable de la question du « professionnalisme de la presse » qui, doit-on encore le rappeler, n’en est pas moins une exigence de la démocratie. Car si les transitions démocratiques et la démocratie comme modèle social font de la liberté d’expression et d’opinion une condition et un pilier à la fois, c’est pour affirmer la responsabilité sociale et politique des métiers du débat et de la communication, celui du journalisme en particulier.
Or, précisément, dans le débat que nous posons, il semble à mes yeux qu’il faut interroger l’incapacité de la presse à assumer ces libertés-là qu’elle aurait elle-même, dans sa prétention avant-gardiste, arraché aux contingences historiques. C’est autrement dit la question de la responsabilité sociale de notre presse et de notre classe politique qu’il s’agit de discuter. En effet, ces deux pôles ont tendance à insister sur les « droits » et les « libertés » plutôt que sur leurs conséquences et leurs implications dans le cadre général de la démocratisation de la société.
Le personnel politique entre « tradition » et « modernité » ?
Pour les hommes politiques, cette clochardisation est à relativiser, voir même à être désignée autrement. Il ne s’agit pas d’une précarisation financière, pas plus qu’une mise sous indigence salariale ou pécuniaire qui serait causée par la fin des prébendes et d’autres privilèges constituant les retombées du système de gratification qui caractérise le modèle « patrimoniale »5 de la démocratie sénégalaise. Pour preuve, la multiplication des partis politiques à une vitesse vertigineuse sous le régime de Wade a moins à voir avec les nécessités ou les processus réguliers du pluralisme.
Elle était plutôt organisée comme une réponse logique à un stimulus prébendier du clientélisme que Wade avait érigé en outil d’émiettement de l’opposition et d’élargissement de sa base clientélaire afin de construire et de s’assurer un contrôle plus efficient sur les mécanismes du jeu démocratique. Il en est de même de la presse ; la plupart des entreprises de presse qui sont nées sous le régime de Wade étaient des sortes de brigades au sein d’un Armageddon propagandiste à sa faveur et contre ses opposants et les forces contre-hégémoniques.
D’autres étaient destinées à enrichir ses clients qui, en échange, s’acquittaient bien de leur rôle de défense et de légitimation de son régime. Les rares entreprises de presse qui étaient apparues comme des produits de la consolidation démocratique et avaient tenu à s’en réclamer avaient été par la suite sevrées et brimées : on en a pour illustration, d’une part, les plaintes des entreprises par rapport à la distribution de l’aide à la presse et, de l’autre, les nombreux cas de brigandages contre des journalistes et des patrons de presse indociles.
Cette clochardisation des hommes politiques est moins d’ordre économique que psychologique et intellectuel. Elle concerne davantage le statut politique, la compétence politique et le prestige du personnel politique ou de la classe politique en général. Le système de Wade reposait sur la violence politique sous toutes ses formes connues : la violence verbale affectionne l’intoxication, la calomnie, l’insulte et la menace par des attaques ciblées ; la violence physique est confiée à des hommes de main responsabilisés au plus haut niveau du parti et de l’Etat ; la violence économique exercée contre d’honnêtes fortunés et des opposants, contre des maisons de presse pour s’accaparer de leurs biens ou leur fermer le robinet afin de les neutraliser à défaut d’obtenir leur soutien.
C’est dans ce contexte que, condamnés à survivre ou déterminés à résister, les victimes ont usé les uns et les autres des mêmes procédés ou cédé au « bolchévisme » du système. Il en a résulté un abaissement du niveau des débats voire le non-débat parfois, dans la mesure où la politique ne se fait plus pour ses buts ultimes (approfondissement des libertés, assainissement du jeu politique, renforcement de la démocratie par l’inclusion et la conscientisation des citoyens, etc.), mais précisément pour duper et divertir au lieu de convaincre.
On voit bien comment les postures politiques déterminées par ce système totalitaire cèdent souvent à la tentation de la soumission, de la rébellion ou de la résignation. La majeure partie du personnel politique éprouve du mal à sortir de ce cercle et à s’affranchir de cette culture politique de la survie. Il est vrai que cette manière de faire de la politique paraît plus commode pour ceux qui tiennent plus à assurer leur survie qu’à changer le système. Or le fait non moins paradigmatique que la politique est toujours érigée en métier au Sénégal conforte le personnel politique dans ses réflexes prédateurs et bellicistes.
La violence prend ainsi la place du débat dans les rapports sociaux afin de censurer les dissonances idéologiques et intellectuelles et les dissidences militantes ou associatives des partis, de la société civile et parfois des pays étrangers et des organisations internationales. Combien de fois le régime de Wade s’est indigné et a réagit sévèrement et avec violence contre des dénonciations et des actions venant de l’étranger ou de la société civile ?
La question demeure de savoir pourquoi la classe politique parait-elle incapable de sortir de cette logique que Pape Sadio Thiam semble qualifier de « traditionnel ». Encore que la « tradition » chez lui n’a pas été clairement nommée dans son analyse. Nous préférons y voir une inclinaison des hommes politiques à recourir à la distribution de prébendes et divers types de privilèges ainsi que du folklore populiste pour mobiliser leur base politique plutôt que d’user de l’éducation citoyenne et du débat d’idées. On ne peut donc s’étonner que cette classe politique, dont la grande majorité est toujours du côté du pouvoir par le système biaisé des coalitions politiques, préfère s’accommoder avec cette « tradition » pour vendre des projets politiques qui d’ailleurs existent rarement ou se ressemblent beaucoup trop pour pouvoir faire émerger un marché compétitif d’idées politiques.
Quelle serait donc la « modernité » que Pape Sadio Thiam sous-entend et semble appeler de ses vœux ? Serait-elle cette modernité politicienne que la classe politique sénégalaise a abandonnée à la société civile, refusant ainsi de la reconnaitre et de l’assumer ? Elle pourrait consister en ce vaste magma d’idées, d’actions et de procédés que la société civile, les syndicats, les corporations, le peuple en général, ont déclinées avec l’efficacité qu’on leur a connue à travers les « assises nationales »6, les marches de protestation, « les émeutes de la vie chère »7, les grèves, sans oublier les nombreux autres épisodes de résistance qui ont atteint leur paroxysme lors des évènements du 23 juin 2011.
Autrement dit, la probabilité et la preuve historique sont que la classe politique sénégalaise est tellement banale et monocolore du point de vue idéologique et culturel qu’elle aura moins à (se) changer elle-même qu’à subir le diktat révolutionnaire des grondements citoyens et des défis socio-économiques et internationaux de la population. Et cette perspective n’est pas sans favoriser les affairistes du débat politique. /.
Aboubakr Tandia
Chercheur, diplômé en science politique
Université Gaston Berger de Saint-Louis