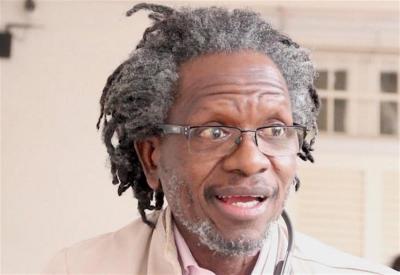LA NÉCESSAIRE TRANSITION VERS UNE NOUVELLE SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE
L’annonce par les États-Unis de nouveaux droits de douane sur les produits africains, couplés à la suppression progressive de l’aide publique au développement à travers l’USAID, marque un tournant silencieux, mais lourd de conséquences...

L’annonce par les États-Unis de nouveaux droits de douane sur les produits africains, couplés à la suppression progressive de l’aide publique au développement à travers l’USAID, marque un tournant silencieux, mais lourd de conséquences dans les relations économiques entre l’Afrique et les États-Unis. Si ces mesures semblent, à première vue, répondre à des impératifs de politique intérieure américaine, elles risquent d’aggraver considérablement les fragilités économiques de nombreux pays africains.Pour des pays comme le Sénégal — déjà confrontés à une conjoncture macroéconomique difficile et à une forte dépendance aux chaînes d’approvisionnement régionales — cette double peine représente un défi à surmonter pour ne pas compromettre des acquis sociaux majeurs.
L’Afrique subit de plein fouet un réalignement géoéconomique qui se fait sans elle, mais dont elle paiera le prix fort comme les autres pays du monde.Choc exogène aux effets multiplesL’imposition par les États-Unis de nouveaux droits de douane sur certains produits africains vient perturber profondément la dynamique commerciale entre le continent et la première puissance économique mondiale. Le Sénégal, bien que n’étant pas un partenaire commercial de premier plan pour Washington, pourrait néanmoins subir des effets collatéraux significatifs, notamment en raison de la tarification appliquée, estimée à 10 % sur plusieurs catégories d’importations.
En 2024, selon les statistiques du gouvernement américain, les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Sénégal ont totalisé 586 millions de dollars, dont 350,9 millions de dollars d’exportations américaines et 235,1 millions de dollars d’importations sénégalaises. Il en résulte un excédent commercial américain de 115,7 millions de dollars. Mais avec les nouvelles taxes américaines, la compétitivité de ces exportations sera mise à mal, et on pourrait engendrer une baisse anticipée des volumes échangés.Près de la moitié des pays africains seront frappés par un tarif uniforme de 10 %, ce qui représente déjà un frein significatif à leurs exportations. Mais la situation est encore plus alarmante pour certaines économies clés : le Nigeria et l’Afrique du Sud voient leurs produits taxés à hauteur de 14 % et 30 %, compromettant leur compétitivité sur le marché américain.
Pour l’Afrique du Sud, l’impact est déjà tangible. L’African Citrus Growers Association a alerté que les taxes de 30 % imposées par les États-Unis sur les agrumes risquent de détruire 35 000 emplois, menaçant la survie économique de plusieurs localités rurales.Le cas le plus dramatique reste celui du Lesotho, dont les exportations seront désormais taxées à un taux punitif de 50 %, mettant en péril la survie de son industrie textile. Au Madagascar, c’est tout le secteur de l’habillement qui vacille sous le poids de droits de douane écrasants de 47 %, menaçant des milliers d’emplois et accentuant la vulnérabilité économique du pays. Effet sur les chaînes d’approvisionnement Le Sénégal, en tant que carrefour logistique stratégique au sein de la CEDEAO, repose sur des chaînes d’approvisionnement régionales profondément intégrées.
La baisse de la demande américaine, induite par les nouveaux tarifs douaniers, exerce une pression indirecte, mais réelle sur les revenus fiscaux, les recettes douanières et les entrées de devises étrangères. À court terme, cette situation a le pouvoir de compromettre la capacité de l’État à mobiliser les ressources nécessaires au financement de l’économie. Cette conjoncture défavorable vient s’ajouter aux déséquilibres structurels hérités du précédent gouvernement, aggravant les défis budgétaires et sociaux auxquels l’administration actuelle tente de faire face dans un contexte de transition politique et d’aspiration à une souveraineté économique renouvelée.Mais cette pression ne s’arrêtera pas aux frontières du Sénégal; elle affectera l’ensemble de l’espace ouest-africain, où les économies interdépendantes pourraient être confrontées à un ralentissement généralisé du commerce régional.
Retrait précipité de l’USAID L’USAID, bras principal de la diplomatie humanitaire et de développement des États-Unis, a été supprimée dans le cadre d’un recentrage budgétaire initié par l’administration américaine. En 2024, l’Afrique subsaharienne recevait environ 12 milliards USD d’aide via l’USAID. Des pays comme le Sénégal, le Nigéria, la RDC et l’Éthiopie bénéficiaient de programmes dans les domaines de l’électricité, de la santé, de l’agriculture, de la gouvernance, de l’eau et de l’éducation.La coupure brutale de ces aides affecte directement plus de 25 millions de bénéficiaires à travers le continent. Au Sénégal, les premiers secteurs touchés sont :Le programme d’accès à l’énergie propre et à l’électricitéLes programmes de lutte contre le paludisme et le VIH/SidaLes projets de résilience climatique et d’agriculture intelligenteLes appuis à l’entrepreneuriat fémininLes subventions aux organisations communautairesUn rapport du Center for Global Development estime que le retrait des financements américains provoquera une hausse de 18 % de la mortalité infantile dans les zones rurales du Sahel si aucune solution alternative n’est trouvée. Quelles perspectives pour l’Afrique ?
La fin de l’USAID et les tensions commerciales avec les États-Unis accélèrent un mouvement de réorientation géopolitique et commerciale. De plus en plus de pays africains, y compris le Sénégal, se tournent vers un partenariat plus diversifié avec d’autres pays comme la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis et l’Union européenne. Toutefois, l’activation de la Zone de libre-échange africaine (Zlecaf) devient un impératif de développement du continent dans un contexte où les alliances stratégiques se dessinent partout à travers le monde.Le gouvernement actuel du Sénégal ne cesse souligner sa volonté de bâtir une souveraineté économique réelle, fondée sur nos ressources, nos compétences et nos choix stratégiques. Cette situation reste une fenêtre d’opportunité pour mettre cette vision en pratique.
Il s’agit là d’une volonté claire de rééquilibrer les rapports de force internationaux et de renforcer l’indépendance économique du continent par la coopération Sud-Sud, l’industrialisation locale et l’autofinancement du développement.Besoin urgent d’un mécanisme panafricain de résilienceFace à la volatilité de l’aide internationale et à l’instabilité commerciale mondiale, il pourrait être pertinent de mettre en place un Fonds africain de résilience socio-économique, financé par les États membres de l’Union africaine, la BAD et les partenaires privés. Ce fonds pourrait financer les programmes sociaux en cas de retrait de bailleurs, stabiliser les économies vulnérables aux chocs extérieurs et soutenir la reconversion des travailleurs licenciés par les ONG. Un tel mécanisme pourrait atténuer les conséquences à court terme des décisions unilatérales des puissances étrangères sur le continent africain.
Alerte pour un réveil collectifLes nouvelles barrières commerciales imposées par les États-Unis, combinées à l’élimination soudaine de l’aide au développement via l’USAID, révèlent une dure réalité : la dépendance structurelle de nombreuses économies africaines aux choix politiques de puissances extérieures. Pour le Sénégal et ses voisins, ces décisions constituent un signal d’alarme, mais aussi une opportunité de repenser les modèles de développement, d’investissement et de coopération.Ce choc, bien que douloureux, pourrait devenir un tournant historique si les dirigeants africains s’unissent pour renforcer les chaînes de valeur locales, investir dans les compétences de la jeunesse, et forger des alliances équilibrées. L’heure est venue de placer la souveraineté économique et sociale au cœur des priorités. Comme nous l’enseigne le sage proverbe africain, « Quand les racines sont profondes, il n’y a aucune raison de craindre le vent. »